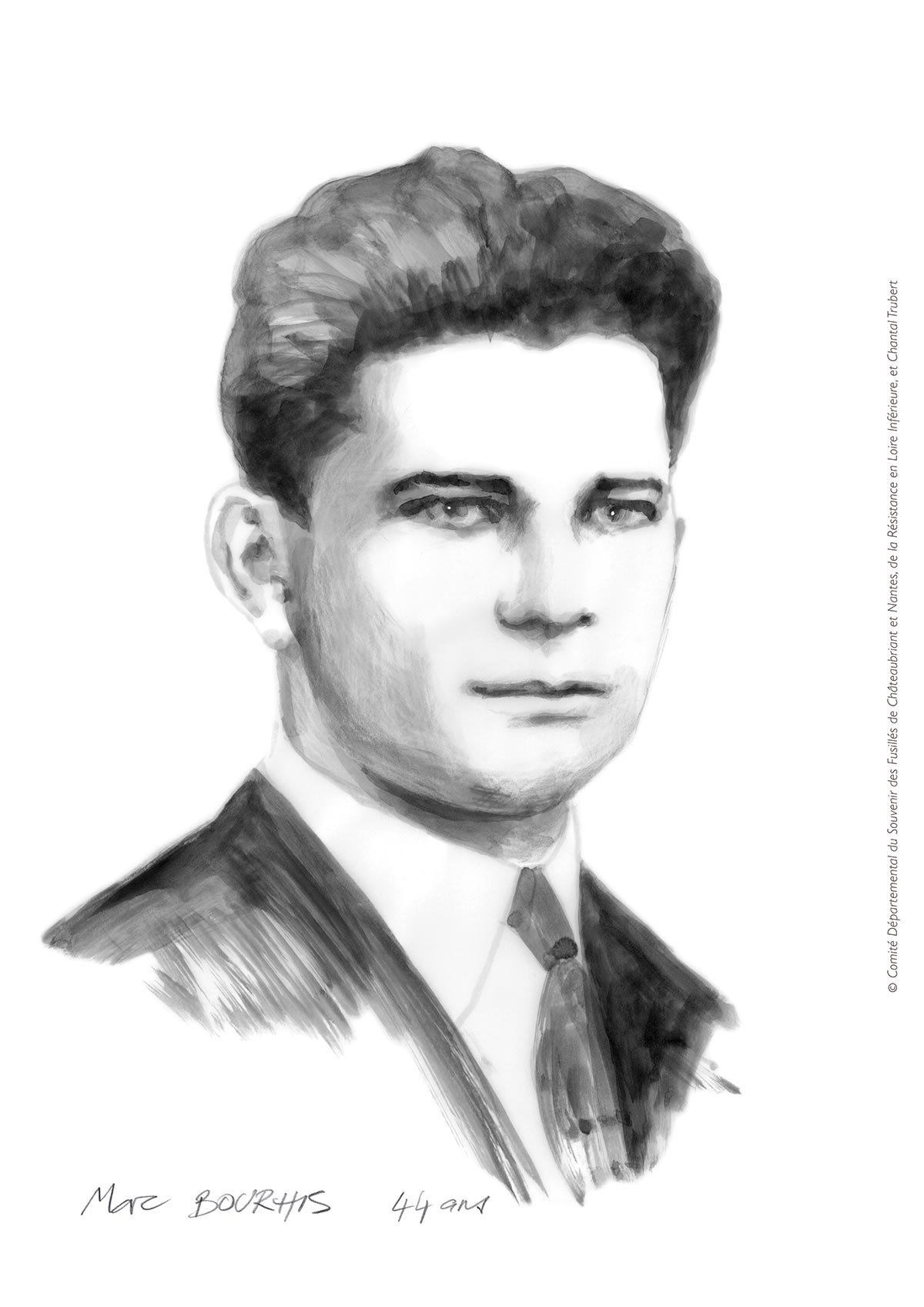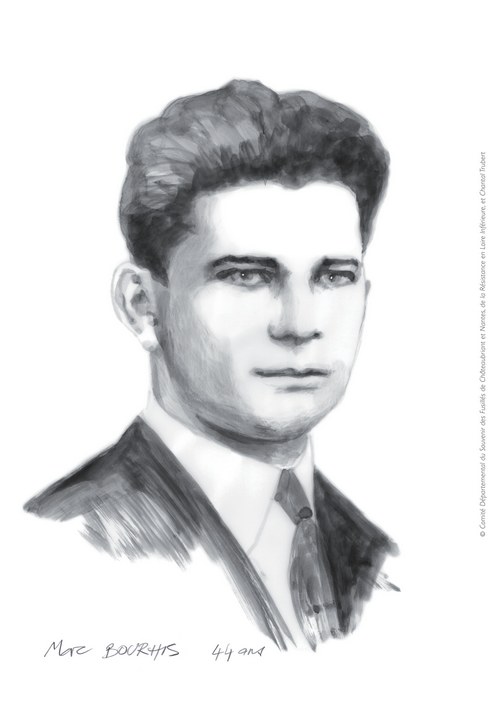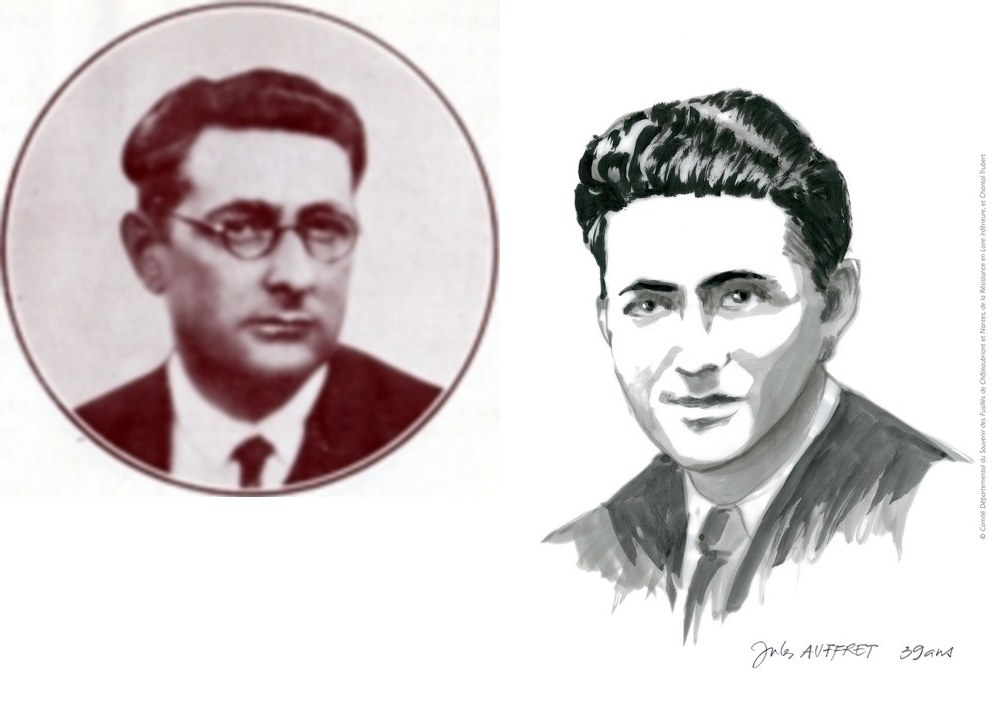Guy MÔQUET



Le père de Guy Môquet, Prosper Môquet, syndicaliste cheminot, militant endurci, fut élu député en 1936 sous le Front populaire. Resté fidèle à la ligne de son parti en septembre 1939, il fut, comme tous ses camarades, déchu de son mandat, condamné et déporté en Algérie pendant toute la durée de la guerre parmi ceux que les communistes devaient appeler les députés du « chemin de l’honneur ». L’oncle et la tante du jeune Guy, Henri et Rosalie Môquet, également militants parisiens de confiance, prirent à partir de 1940 leur place dans les structures clandestines de l’appareil communiste. La mère, Juliette, était également sympathisante communiste.
Enfant à l’esprit vif, « titi parisien » ayant grandi dans le quartier Clignancourt, Guy accompagnait ses parents, puis son frère cadet Serge, dans les manifestations et fêtes populaires de la capitale. Les vacances d’été se passaient chez la grand-mère, à Bréhal dans la Manche. Il entra au lycée Carnot à l’âge de six ans, y afficha sans complexe ses opinions politiques, ce qui lui valut d’être renvoyé à la fin de la classe de septième (CM2). Entré alors à l’école communale de son quartier, il y passa son certificat d’études à l’âge de douze ans, au moment où triomphait le Front populaire. Le père fut élu parmi les soixante-douze députés communistes. La famille déménagea alors dans l’arrondissement voisin, au 34 rue Baron dans le XVIIe, quartier des Batignolles, et Guy Môquet décida de retourner au lycée Carnot dont il suivit les cours jusqu’en classe de troisième. Il était bon élève, aimait à composer des poèmes, excellait en sport, jouait de l’harmonica, savait charmer les filles… Il militait déjà aux Jeunesses communistes.
Lorsque son père fut arrêté en octobre 1939 avec les autres députés communistes, il le visita régulièrement en prison, écrivit un poème en alexandrins au président de la République pour demander sa libération, et participa activement à la campagne locale en sa faveur. L’appartement familial était le lieu de fréquentes réunions. Quand Paris fut occupé, en juin 1940, il ne tarda pas à revenir à vélo de Normandie où il s’était réfugié avec sa mère et son frère. Une poignée de jeunes communistes du XVIIe se réunirent clandestinement dans les « fortifs » et le choisirent comme responsable. Ce fut le début des distributions de tracts à la volée, des collages de papillons ou d’inscriptions de slogans à la craie ou à la peinture. Le dernier rapport du jeune secrétaire revendiquait vingt-quatre militants dans son secteur, et trois arrêtés et détenus à la Santé.
Guy Môquet fut lui-même arrêté par des policiers français le dimanche 13 octobre 1940 alors qu’il attendait à un rendez-vous dans le hall de la gare de l’Est. Quelques-uns de ses camarades avaient été pincés peu avant. Refusant de parler, une perquisition chez lui n’ayant rien donné, il fut durement tabassé par les hommes de la Brigade spéciale à la préfecture de police. Transporté à la prison de la Santé puis à Fresnes (Seine, Val-de-Marne), maltraité par des jeunes droits communs, il fut finalement enfermé avec d’autres politiques grâce à l’insistance de sa mère. Jugé le 23 janvier 1941 après cent jours de prison avec trois de ses camarades impliqués comme lui, il fut acquitté par le tribunal, faute de preuves, alors que les autres, qui avaient parlé, furent condamnés à plusieurs mois de prison. Mais il ne fut pas libéré pour autant. Il fut gardé au dépôt de la préfecture de police, puis à nouveau à la Santé, où il connut plusieurs jours de cachot pour avoir manifesté avec d’autres pour le droit de recevoir des colis de nourriture. Après quelques semaines, il fut transféré en train le 27 février à la centrale de Clairvaux, dans l’Aube, où il retrouva plusieurs responsables importants du Parti communiste qu’il avait connus par son père : Henri Reynaud, Jean-Pierre Timbaud, Jean Grandel, Léon Mauvais, Eugène Hénaff, Fernand Grenier, Charles Michels… On lui fit bon accueil, et il mit ces trois mois de détention à profit pour améliorer sa formation politique. Il fêta ses dix-sept ans en compagnie de ses camarades.
Le 10 mai 1941 (ou le 1’ selon les sources), les militants communistes de Clairvaux furent acheminés au camp de Choisel, à Châteaubriant (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique). Dans les baraquements, les cours de formation reprirent ; avec ses copains Rino Scolari, Roger Sémat et d’autres, Guy Môquet, favorisé par sa belle constitution, aimait s’adonner aux exercices sportifs dont Auguste Delaune était l’animateur. Il était le benjamin du camp. Tous les quinze jours, les détenus pouvaient recevoir un colis de leur famille. Guy Môquet écrivait régulièrement de longues lettres affectueuses à ses parents et, en juin, il reçut la visite de sa mère et de son frère. Le même mois, l’évasion réussie de Reynaud et Grenier, puis le lendemain de Mauvais et Hénaff, déclencha une fouille approfondie du camp et le remplacement par les autorités allemandes de l’officier français qui le commandait. Deux jours plus tard, l’armée allemande envahissait le territoire soviétique, ce qui décidait le Parti communiste à commencer les attentats armés contre les forces d’Occupation. Séparées du camp des hommes par une palissade de faible hauteur surmontée de barbelés, les femmes, et notamment les jeunes filles, parmi lesquelles se comptaient aussi un grand nombre de militantes communistes, venaient souvent deviser avec leurs compagnons de détention. C’est ainsi que se noua l’idylle entre Guy Môquet et Odette Lecland (Nilès après son mariage), arrivée au camp en septembre 1941. L’entrain du jeune garçon la séduisit ; elle avait son âge exactement, et lui promit un baiser…
Le 19 octobre 1941, le commandant allemand de la région de Nantes, Karl Hotz, fut abattu par un commando de jeunes résistants communistes. La réaction fut immédiate : plusieurs dizaines d’otages furent exécutés. Le camp de Châteaubriant, peu éloigné du lieu de l’attentat, idéalement peuplé de militants communistes importants, devait fournir un contingent d’une trentaine d’hommes. Un détachement de SS vint les chercher. Ils furent désignés par le commandant du camp, d’après les consignes de Pierre Pucheu, ministre de l’Intérieur de Vichy, et des autorités d’occupation. Certains, comme Timbaud ou Michels, ne se faisaient aucune illusion sur leur sort. Mais lorsque Guy Môquet fut appelé, ce fut une surprise consternée. Certains insistèrent pour que leur trop jeune camarade soit épargné, mais lui fit face avec courage. Trois autres condamnés n’avaient pas encore vingt et un ans. Un prêtre du voisinage s’entretint fraternellement avec les vingt-sept hommes, après que le curé de Châteaubriant eut refusé d’assister des communistes. Ils eurent une demi-heure pour écrire une lettre à leurs proches. Guy Môquet griffonna cette vingtaine de lignes qui devaient connaître la notoriété lorsqu’on les retrouva plus tard parmi les papiers de ses parents, adressées à « Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé ». Sa mère reçut sa missive (actuellement conservée au Musée de la Résistance de Champigny), et la recopia pour en envoyer une copie à son père détenu en Algérie, non sans avoir au préalable écrit à un de ses codétenus de le préparer à la triste nouvelle. Une seule phrase de la lettre a une certaine portée politique : « Ce que je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort serve à quelque chose. » Les hommes furent ensuite embarqués dans des camions sous les yeux de leurs codétenus, aux chants de « La Marseillaise » et de « L’Internationale » ; transportés dans une clairière où avaient été érigés neuf poteaux, ils furent fusillés en trois groupes. Seize autres otages furent exécutés à Nantes, et cinq au Mont-Valérien (commune de Suresnes, Seine, Hauts-de-Seine), en représailles à l’exécution de Karl Hotz. Quelques jours après l’exécution, le général de Gaulle, de Londres, salua la mémoire des fusillés. Churchill et Roosevelt manifestèrent également publiquement leur réprobation. Après la guerre, le chef de la France libre devait encore manifester sa sympathie à Prosper Môquet à plusieurs reprises.
Guy Môquet avait encore pu glisser à un gendarme un court billet d’adieu destiné à Odette. La « petite fiancée » éplorée se le vit remettre, et le conserva, ne le rendant public que dans son grand âge. Les parents Môquet eurent encore la douleur de perdre leur autre fils, Serge, emporté par la maladie avant la fin de la guerre. Le corps de Guy Môquet, d’abord enterré comme celui de ses camarades dans un cimetière du voisinage, fut plus tard transféré au Père-Lachaise à Paris. D’emblée, le jeune martyr fut popularisé et mis en avant par la propagande clandestine de son parti. Jacques Duclos chargea l’avocat Joë Nordmann d’obtenir des témoignages clandestinement transmis de Châteaubriant afin de les ériger en « un monument ». Le juriste réussit à trouver Aragon à Nice, qui se mit aussitôt au travail et bientôt, le texte du Témoin des martyrs circulait sous le manteau dans toute la France, et fut publié aux Éditions de Minuit en 1943. Pour le PCF, Guy Môquet fut d’abord associé, pendant les années de guerre, aux jeunes héros patriotiques du passé tels que Jeanne d’Arc ou Joseph Bara. Dès l’année 1941, un groupe de combattants Francs-tireurs et partisans (FTP) de Franche-Comté prit le nom de Guy Môquet, et compta bientôt aussi plusieurs victimes d’exécutions. Au premier anniversaire de l’exécution, plusieurs actions clandestines eurent lieu pour rendre hommage aux morts ; une rue de Chagny (Saône-et-Loire), par exemple, fut rebaptisée au nom de Guy Môquet, avec une manifestation d’appui de quelques centaines de personnes. Aragon, encore, composa en 1943 le poème La Rose et le Réséda qu’il dédicaça l’année suivante à quatre martyrs de la Résistance, deux catholiques et deux communistes, parmi lesquels Guy Môquet ; le poète René-Guy Cadou, qui avait vu passer les camions bâchés des condamnés et entendu leurs chants, consacra un poème aux fusillés de Châteaubriant.
À la Libération, Guy Môquet fut invariablement cité aux côtés des autres figures emblématiques de la jeunesse communiste résistante : le colonel Fabien, mort pendant les combats de la Libération, ou Danielle Casanova, morte en déportation. Certains nouveau-nés furent même honorés de son nom. On assista à une véritable floraison d’hommages, y compris les honneurs officiels de la République (Médaille de la Résistance et Croix de guerre). Une cellule du PCF du XVIIe arrondissement de Paris adopta son nom, ainsi qu’une chorale des JC, principalement implantée dans les XIXe et XXe arrondissements (Henri Krasucki en faisait partie), qui anima pendant des années toutes les fêtes et les galas de la région parisienne. Des commémorations étaient organisées devant la maison de la rue Baron, et très régulièrement, jusqu’à aujourd’hui, dans la carrière de Châteaubriant, où un monument a été érigé en mémoire des suppliciés. À Paris, la rue Auguste-Balagny (le dernier maire des Batignolles-Monceau) et la station de métro Marcadet-Balagny, proches de son domicile, furent rebaptisées à son nom. Bientôt, une cinquantaine de villes de France, et pas seulement dans la banlieue rouge, inaugurèrent des rues ou des boulevards Guy-Môquet, puis des gymnases, des piscines, des stades, des maisons des jeunes, des collèges, un lycée (à Châteaubriant).
Le temps commençait à faire son œuvre d’oubli, malgré la mise en chanson de sa lettre à ses parents par Marc Ogeret dans les années 1990, quand une petite biographie parue en 2000 et l’éclaircissement de la politique suivie par le PCF dans les années 1939-1941 par l’ouverture des archives communistes et les travaux des historiens motivèrent Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre à publier en 2004 un livre qui eut un certain retentissement, Le Sang des communistes. Guy Môquet n’en était pas l’objet principal, mais ils y démystifiaient la résistance communiste antérieure à l’invasion de l’URSS de juin 1941 et démontraient les limites et les errements de la lutte armée des JC après cette date. Selon eux, les communistes popularisaient la mémoire de Guy Môquet, arrêté avant juin 1941, pour mieux occulter la compromission soviétique avec l’Allemagne nazie avant cette date.
Mais c’est à Nicolas Sarkozy, candidat de droite à la présidence de la République en 2007, qu’il revint d’avoir remis au premier plan la figure du jeune communiste. Dans la lignée de sa stratégie consistant à récupérer certains mythes (et certains hommes politiques du moment) de la gauche, à commencer par Jean Jaurès, il prôna à plusieurs reprises au cours de sa campagne l’exemple de courage et de patriotisme attribué au jeune Môquet, soulevant l’indignation de ses adversaires communistes qui s’estimaient seuls en droit de brandir l’icône. Une fois élu, Sarkozy persista en proposant que la lettre de Guy Môquet soit lue dans toutes les classes des lycées de France, en vertu de cette vision idéalisée soutenue par la portée émotionnelle que son destin tragique était censé transmettre. L’initiative, rendue obligatoire par les autorités académiques, souleva une polémique considérable, et suscita un tollé de protestations parmi les enseignants, entériné par l’appel au boycott de leur principal syndicat, le SNES. Un timbre-poste fut émis à l’effigie de Guy Môquet, un court-métrage diffusé sur les chaînes publiques ; ses photographies au camp, vêtu du pull-over à carreaux que lui avait tricoté sa mère, devinrent connues de tous. Les débats furent d’une telle ampleur que, malgré une application limitée sur le terrain, la directive et la polémique ressuscitèrent le souvenir du jeune garçon. Deux ans plus tard, en 2009, un conseiller présidentiel et un ministre rappelaient encore que la lecture de la lettre restait obligatoire dans les classes ; mais aucune sanction ne fut prononcée.
Des historiens profitèrent de l’émoi pour écrire de nouvelles études biographiques ; celle de 2000 fut republiée en livre de poche, en même temps que de petits pamphlets rageurs émanant de bords opposés, ou une bio-fiction d’un auteur communiste ; le PCF relança une campagne d’affichage qui actualisait l’exemple du jeune communiste par la phrase « Aujourd’hui, demain, combattre » ; Odette Nilès, devenue présidente de l’Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé, publia son témoignage ; deux films de fiction inspirés de cette histoire furent produits par et pour la télévision. J.-M. Berlière et F. Liaigre publièrent un autre livre, plus court et incisif, qui s’attachait plus nettement encore, en s’appuyant sur l’exemple de Môquet, à dénier aux communistes la qualité de résistants avant l’invasion de l’URSS, et à démontrer la sélectivité des martyrs de la résistance qu’ils mettaient en avant, soulevant une forte émotion polémique dans les médias de bords opposés.
Il ne fait guère de doute que s’il avait encore été en liberté au début de l’été 1941, Guy Môquet aurait, comme la plupart de ses jeunes camarades, été engagé dans la lutte armée contre les occupants derrière Albert Ouzoulias et Pierre Georges (le futur colonel Fabien) ; et il aurait peut-être, comme tant d’autres, subi avec un ou deux ans de retard le sort qui fut le sien. Voilà pourquoi, s’il n’est pas inutile de rappeler que lors des actions qui lui ont valu son arrestation il n’était guère question encore pour les communistes de s’attaquer aux occupants, mais davantage aux fauteurs de guerre et de défaite français, si l’on peut admettre le débat sur l’efficacité et la portée du sacrifice de cette génération de jeunes militants qui ont ensuite exacerbé leur combat quand leur parti le leur ordonna, il paraît vain, en revanche, de se demander si Guy Môquet mérite ou non l’appellation de résistant. Il a en tout cas été reconnu et décoré comme tel à titre posthume au nom de la République, quand elle fut rétablie : médaillé de la Résistance, « Mort pour la France », Croix de guerre 1939-1945 (déc. 1944), chevalier de la Légion d’honneur (nov. 1946).
Le 27 janvier 1946, la station du Métro parisien « Marcadet-Balagny » a été rebaptisée « Guy Môquet ».
La lettre de Guy Môquet ne figurait pas dans la première édition des Lettres de fusillés, Éditions France d’Abord, 1946. On la trouve dans l’édition plus légère de 1958, préface de Jacques Duclos, Éditions sociales, p. 22-23 et dans l’édition de 1970, p. 35-36.
Châteaubriant, le 22 octobre 1941
Ma petite maman chérie,
Mon tout petit frère adoré
Mon petit papa aimé,
Je vais mourir ! Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c’est d’être courageuse. Je le suis et je veux l’être autant que ceux qui sont passes avant moi
Certes, j’aurai voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon coeur, c’est que ma mort serve a quelque chose . Je n’ai pas eu le temps d’embrasser Jean ; j’ai embrassé mes deux frères, Roger et Rino Quant au véritable, je ne peux pas le faire, hélas
J’espère que toutes mes affaires te seront renvoyées ; elles pourront servir a Serge qui, je l’escompte, sera fier de les porter un jour.
A toi, petit papa, si je t’ai fait, ainsi qu’a petite maman bien des peines, je te salue une dernière fois.
Sache que J’ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m’as tracée.
Un dernier adieu a tous mes amis, a mon frère que j’aime beaucoup. Qu’il étudie bien pour être plus tard un homme.
Dix-sept ans et demi Ma vie a été courte ! Je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michels. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être courageuse et de surmonter ta peine
Je ne peux pas en mettre davantage Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Séserge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d’enfant
Courage !
Votre Guy qui vous aime
GUY
Dernière pensée « Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les vingt-sept qui allons mourir. »
SOURCES : DAVCC, Caen, B VIII, dossier (Notes Thomas Pouty). – Tracts et journaux communistes des années d’Occupation et de Libération, aux Archives du PCF (Arch. Dép. Seine-Saint-Denis, Bobigny) et aux Archives du Musée de la Résistance nationale (Champigny, Val-de-Marne). – Louis Aragon, Le Témoin des martyrs, Paris, Éd. de Minuit, 1944. – Max Rainat, Guy Môquet, étudiant, fusillé par les hitlériens le 22 octobre 1941, héros patriote de dix-sept ans, mort pour une vie plus belle, Éd. Sociales, 1949. – Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, Éd. Sociales, 1961. – Albert Ouzoulias, Les Bataillons de la jeunesse, Éd. Sociales, 1969. – André Tollet, La Classe ouvrière dans la Résistance, Éd. Sociales, 1969. – Joë Nordmann et Anne Brunel, Aux Vents de l’histoire. Mémoires, Actes Sud, 1996. – Pierre-Louis Basse, Guy Môquet. Une enfance fusillée, Stock, 2000. – Guy Krivopissko (présentation), La vie à en mourir. Lettres de fusillés (1941-1944), Tallandier, 2003. – Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Le Sang des communistes. Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée. Automne 1941, Fayard, 2004. – Jean-Pierre Azéma, « Guy Môquet, Sarkozy et le roman national », L’Histoire, no 323, sept. 2007. – Pierre-Louis Basse, Guy Môquet au Fouquet’s. Pamphlet, Éd. des Équateurs, 2007. – Nancy Bosson, Guy Môquet, « J’aurais voulu vivre », Éd. Libra Diffusio, sept. 2007. – Gérard Streiff, Guy Môquet. Châteaubriant, le 22 octobre 1941, Le Temps des Cerises, 2007. – Michel Etiévent, J’aurais voulu vivre…, Éd. Gap, 2007. – Pierre Schill, « Guy Môquet », in Laurence De Cock, Fanny Madeline, Nicolas Offenstadt, Sophie Wahnich (sous la dir.), Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France, Agone, 2008. – Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé (Yves Doucet, coordinateur), 22 octobre 1941, « Soyez dignes de nous », album de textes et photos, Éd. Cultures et Diffusion, 2008. – Benoît Rayski, Le cadavre était trop grand. Guy Môquet piétiné par le conformisme de gauche, Denoël, 2008. – Odette Nilès et Serge Filippini, Guy Môquet, mon amour de jeunesse, L’Archipel, 2008. – Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, L’affaire Guy Môquet. Enquête sur une mystification officielle, Larousse, 2009. – Article en ligne « Guy Môquet », Wikipédia. – Philippe Bérenger, Brigitte Peskine, Guy Môquet, un amour fusillé, France Télévisions, 2008, film fiction. – Volker Schlöndorf, Pierre-Louis Basse, La Mer à l’aube. Les dernières heures de Guy Môquet, Arte, 2012, téléfilm. – Témoignages de Paulette Bouchoux-Capliez, ancienne internée au camp de Châteaubriant ; de René Roy, ancien résistant des JC, 2010-2012.

Marc Giovaninetti