J’étais : la fille à la chaussette
Gisèle Giraudeau est née à St Vincent des Landes en 1923, il n’y est restée que 4 ans, rejoignant son père à la gare de Treillières où il travaillait. Elle se souvient très bien de la déclaration de guerre, des Allemands contournant la ligne Maginot, des réfugiés du Nord qu’il fallait loger à la gare. Elle se souvient des impatiences de son frère, Joseph Fraud, son aïné de trois ans, qui voulait partir en Angleterre, par l’Espagne. Avec lui, elle a quitté la maison, à vélo, mais les deux jeunes gens ont été stoppés à la ligne de démarcation à Eymoutiers à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Limoges. « Après l’armistice du 22 juin 1940, nous sommes donc revenus à Treillières, très déçus ».
Février 1943, Joseph Fraud, refusant le STO (service du Travail Obligatoire), est caché en gare par des cheminots avant de pouvoir participer de façon plus active. C’est alors qu’il fait la connaissance de Libertaire Rutigliano et entre au Front National de la Résistance et de la Libération de la France.
« Moi je travaillais au service régional des assurances sociales à Nantes. Et, le week-end, à la demande de mon frère, je frappais les stencils servant à imprimer des journaux clandestins : Le Front des Ouvriers, le Front des Paysans, le Front des Universitaires, etc. Les journaux étaient cachés dans un cabanon au fond du jardin de Rutigliano et des camarades venaient les chercher pour les distribuer. Je m’occupais aussi de trouver des chambres pour les maquisards »
Le frère de Gisèle lui avait dit : « tu ne parles de rien à personne ». « J’ai respecté la consigne mais, au boulot, on en parlait beaucoup de ces journaux. Un jour, en mars 1944, un paquet de journaux a été trouvé aux Chantiers de Bretagne. La police est remontée jusqu’à l’ouvrier qui l’avait apporté, et plus haut dans la filière, c’est ainsi qu’ils ont arrêté mes amies, Jeannette Alain et Marcelle Baron à l’usine métallurgique Brissonneau ».
Gisèle s’interroge alors : partir ? « Mais si je partais, mes parents trinqueraient. Je suis restée. Cette fois-là, ce n’est pas moi qu’on cherchait. On cherchait DUHART, c’était le nom de guerre de mon frère ».
Le 3 avril 1944, Gisèle est arrêtée à son tour. « La Gestapo m’a emmenée dans ses locaux, rue du Maréchal Joffre. J’y ai retrouvé une amie qui m’a seulement dit en m’embrassant : je n’ai pas pu tenir. Le soldat de la Gestapo m’a flanqué une violente claque, je suis tombée et j’ai été emmenée dans les caves. J’ai été questionnée, torturée pour que je dise où était Duhart mais je n’ai rien dit. Dans les cellules voisines j’entendais les plaintes d’autres personnes. J’avais peur. Dans des situations comme cela, on implore le ciel, on essaie de répondre n’importe quoi, j’ai tenu »
Le 8 avril 1944, la Gestapo emmène Gisèle sur le quai de la gare de Nantes : elle doit servir d’appât pour arrêter d’autres résistants. La gestapo veille à proximité. « Ma sœur, 16 ans, est sortie du train avec un ami. Quand elle est passée à côté de moi, elle m’a dit discrètement « il est à l’abri ». En effet, Joseph, prévenu, était descendu du train à Nantes, par les voies et, équipé d’un vélo, avait filé vers Treillières.
Gisèle est alors emmenée par les Allemands jusqu’à Treillières. « Par la fenêtre, j’aperçois mon frère à l’étage. Les Allemands n’avaient rien vu. Moi je me disais : le sort est contre nous ». En entrant dans la maison de ses parents, Gisèle prend quelques secondes pour cajoler son chat venu lui faire fête : ce court laps de temps permet au jeune homme de descendre se cacher dans la cave. La porte de celle-ci, bien dissimulée, n’est pas repérée par les Allemands. « Le temps qu’ils interrogent mes parents, j’ai pu me faufiler jusqu’à l’étage et cacher la valise de mon frère sous le lit. Dans ses papiers, il y avait des caricatures d’Hitler ». C’était la veille de Pâques, ce 8 avril 1944. Les Allemands n’ont pas fouillé beaucoup. Joseph n’a pas été trouvé mais Gisèle a été emmenée en prison à Nantes jusqu’au 21 avril. « Votre fille, elle va partir pour l’Allemagne, pour éplucher des pommes de terre » disent les Allemands.
21 avril 1944 : un convoi quitte Nantes, avec 57 hommes dirigés vers Compiègne, un Juif dirigé vers Drancy et deux femmes, Marcelle Baron et Gisèle Fraud, dirigées vers le fort de Romainville, un ancien bastion de type Vauban, construit au XIXe siècle, surveillé par des miradors, ceinturé de grillages déroulés tout au long du chemin de ronde qui serpente sur les hauts murs. Romainville : antichambre des camps nazis.
13 mai 1944, il fait beau, très chaud même. Un colis de la Croix Rouge est remis aux 705 détenues que les Allemands font entrer dans le train à Pontoise. Des wagons à bestiaux avec une étroite ouverture grillagée. « Nous y sommes restées toute la journée, sous le soleil brûlant, nous avions soif. Les cheminots, dans la gare, avaient des bouteilles d’eau mais un cordon d’Allemands empếchait tout contact. Nous ne sommes parties que le soir, celles qui l’ont pu ont écrit de brefs messages jetés sur la voie, acheminés ensuite par ceux qui les trouvaient : c’est ainsi que j’ai pu faire dire à mes parents que je partais pour l’Est ».
Dans le train, les femmes sont anxieuses : pour l’Est ? Pour l’Allemagne ? « Nous sommes entassées dans ce wagon, le colis de la Croix Rouge est terminé. La « tinette » déborde, nauséabonde. Nous avons soif, le matin je passe ma main à travers le vasistas pour recueillir quelques gouttes de rosée sur le toit ».
A la frontière allemande, la Croix Rouge peut offrir un quart de soupe bienvenu. A Berlin, sous les bombardements, le train est bloqué une journée, puis le voyage reprend, il durera en tout cinq jours et quatre nuits. A l’arrivée les femmes sont en mauvais état, épuisées.
Gare de Fürstenberg à 80 km au nord de Berlin. « Nous avions encore nos montres. Il est deux heures du matin. Des projecteurs nous aveuglent. Chiens. Des ordres sont hurlés en allemand : se ranger en colonnes par 5. Celles qui, parmi nous, connaissent cette langue, nous transmettent les ordres. Chercher nos valises. Schnell ! Aider les plus faibles à descendre. Schnell ! Relever celles qui sont tombées. Schnell ! Schnell ! Nous ne sommes pas sur le quai de la gare mais sur les voies et c’est encore plus difficile de descendre ».
Les 705 femmes, en colonne, marchent sur 2-3 km, en direction de Ravensbrück. Elles traversent un bois, cela sentait bon la verdure. Puis elles parcourent une allée bordée de belles maisons, avec des fleurs aux balcons. Timidement l’espoir renaît. Les femmes apprendront vite que ce sont les maisons des gardiens du camp.
Pour elles, voici un immense portail avec des murs de 5 mètres de haut. Et des barbelés. Et toujours les projecteurs et les chiens. « On nous a fait nous ranger dans un coin de la cour et nous mettre par ordre alphabétique : chacune demandait le nom de ses voisines : Une belle pagaille ! Mais enfin ça y est, nous sommes rangées »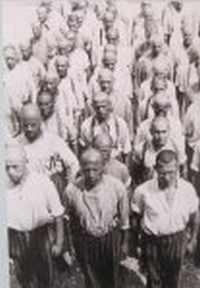
Quatre heures du matin, le jour se lève, « Nous apercevons quelques prisonnières qui nous font de grands signes. Nous finissons par comprendre qu’il faut manger tout ce qui reste dans nos bagages. Nous ne les croyons pas. Nous essayons de leur envoyer quelque chose et nous récoltons des coups de nos gardiens. L’inquiétude nous étreint. Vers 5 heures, le camp s’éveille, des femmes vont chercher des bidons de café. D’autres convergent vers la place d’appel ».
« Nous, on nous fait entrer dans les bureaux : nom, adresse, bijoux, argent. Nos objets précieux sont mis dans une enveloppe qu’on a promis de nous rendre. [Mais nous n’avons rien récupéré !] »
Puis c’est le rituel habituel : déshabillage total, désinfection au grésil (ça pique !). « On nous entasse alors dans une salle, les portes sont fermées. C’est la salle de douche, une douche qui nous fait grand bien après notre voyage. Mais l’alternance du chaud et du froid nous met mal à l’aise. Nous avons la peur au ventre ».
Au sortir de la douche, chacune reçoit un paquetage : robe légère, culotte, chaussures à semelles de bois. « Nous recevons aussi une bande à coudre sur notre robe, avec notre numéro matricule. Et un triangle rouge, car je suis Résistante. Coudre ? Avec quoi ? Nous n’avons rien, mais il faut se débrouiller et surtout retenir ce satané numéro, en allemand. Pour moi : 38 854 »
« Je ne suis plus qu’un numéro : 38854 : achtunddreißigtausendachthundertvierundfünfzig »
Quarantaine

Les 705 femmes sont alors entassées dans une baraque prévue pour 350. Elles se partagent les châlits superposés. Promiscuité. Pas le droit de parler avec des personnes de l’extérieur. C’est la période de quarantaine, 40 jours sans sortir, même pour l’appel. « Ce système d’appel que nous pouvons observer, avec le comptage et le recomptage, les longues séances debout, les chiens, cela ne nous dit rien de bon. Nous avons quand même appris le débarquement du 6 juin 44 car des femmes sont passées en criant le long de notre baraque : le débarquement est fait ». Dans la baraque, les femmes fredonnent La Marseillaise.
« Au dehors, nous apercevons les enfants, en haillons. Ils n’ont rien à manger, ils n’ont même pas de gamelles, rien que des boites de conserve. Ils sont avides de cette nourriture infecte que, au début, nous refusons. Je comprends que c’est l’enfer ». A Ravensbrûck, les femmes qui arrivaient enceintes accouchaient et retournaient très vite au travail. Aucun supplément de nourriture. Les femmes qui pouvaient voler (on disait « organiser ») des gants en caoutchouc en faisaient des biberons de fortune. Seuls trois enfants revinrent de Ravensbrück. « Nous avions des piqûres tous les 2-3 jours, je n’ai jamais su pourquoi. Celle qui demandait recevait une paire de claques. J’ai toujours pensé que ces piqûres provoquaient une modification hormonale car, nous les femmes, nous n’avions plus nos règles »
Zwodau
Gisèle n’est pas restée au camp de Ravensbrück, elle a été dirigée vers le Kommando de Zwodau, dans les Sudètes, qui, au début, dépendait de Ravensbrück. « Trois jours de voyage. L’horizon verdoyant nous a apporté un peu de réconfort. Pas longtemps ».
« A Zwodau, on a demandé des volontaires pour travailler à l’usine Siemens qui fabriquait des pièces pour l’aviation. Personne n’a répondu. Nous avons alors appris qu’il nous faudrait ramasser du charbon dans la mine voisine, à ciel ouvert, pour chauffer les maisons de gardiens et les blocks du camp. Ou travailler à la réfection des routes ou faire du bûcheronnage en forêt. Finalement nous avons accepté l’usine. Là au moins il faisait chaud ».
Lever à 4 h du matin, lit à faire au carré, appel qui dure longtemps, cinq par cinq, même les malades qui pouvaient tenir debout. Attendre qu’on nous compte : la blockova, l’aufseherin, le commandant … et il faut trouver le même nombre ou recommencer à compter. Un liquide noir en guise de café. Se laver. Schnell, schnell. Et partir au travail.
Pour aller travailler, d’abord se ranger, puis marcher au pas en chantant. « Alli Allo, chantaient les premiers rangs. Nous, les Françaises, nous étions en bout de colonne car nous n’avons jamais su marcher au pas, nous ne voulions pas marcher au pas. Et nous chantions : as-tu vu la casquette la casquette, as-tu vu la casquette du père Bugeaud, Elle est faite la casquette, la casquette, Elle est faite avec du poil de chameau ». [vieux chant historique que Radio-Alger avait adopté comme indicatif]
« J’ai appris à manier la perceuse, le tour, la scie circulaire. C’est un Allemand qui m’a appris, il s’est adouci quand il a compris que j’étais là pour faits de Résistance, et pas « droit commun ». J’ai pris tout mon temps pour apprendre le maniement des machines car je ne voulais pas travailler pour l’Allemagne »
Marcelle Baron, dans cette usine, s’efforçait de percer de biais : le trou devenait inutilisable, la mèche cassait. Elle a été tabassée souvent. D’autres filles limaient certaines dents de la scie circulaire : les pièces fabriquées avaient des défauts.
Punies
« Nous travaillions en équipe. Douze heures de jour. Ou douze heures de nuit. Je ne faisais pas partie de la même semaine que mon amie Marcelle Baron et j’en étais très triste. Mais nous, les Françaises, nous nous soutenions beaucoup. Les plus jeunes, comme moi, essayaient de faire rire les autres. Nous n’avions sur le dos qu’une robe légère. La neige a commencé à tomber dès octobre-novembre. En mai 1945 la neige n’avait pas encore fondu. Il faisait -25°. Il fallait tenir cependant ».
Le soir, les appels étaient plus redoutables que le matin, car on pouvait être « appelées » : achtunddreißigtausendachthundertvierundfünfzig, pour avoir parlé, pour avoir passé trop de temps dans les « toilettes », pour avoir déplu tout simplement. C’était alors une liste de punitions, à effectuer le dimanche matin. « C’est ainsi que j’ai déchargé des rutabagas, et des pommes de terre. J’ai transporté des ferrailles aussi et déchargé un wagon de briques. Avec le froid qu’il faisait, cette corvée vous arrachait la peau des mains ».
Une seule fois Gisèle a pu écrire à sa famille, en allemand bien sûr, texte imposé « Je mange bien, je dors bien. Envoyez moi un colis ». « Ma lettre n’est arrivée qu’en décembre 1944, je n’ai jamais eu de colis. Celles d’entre nous qui en ont reçu ont tout partagé. Trois ou quatre morceaux de sucre par personne, un ou deux gâteaux. Le grand plaisir ».
Plus le temps passait, plus la soupe était claire, il fallait la manger dehors, debout, dans la gamelle. Les déportées qui le pouvaient « organisaient » (volaient) des betteraves blanches ou un os à la cuisine, pour le ronger comme elles pouvaient. « J’avais fabriqué un couteau à l’usine, en ponçant un morceau de fer sur une meule. Je le cachais dans ma chaussette. J’étais la fille à la chaussette car mes chaussettes, grises au départ, étaient raccommodées avec des fils de toutes les couleurs donnés par les filles qui travaillaient à la couture ».
Ce calvaire a duré onze mois. « Et puis, début mai 1945, les Allemands nous ont mis sur les routes en direction de Flossenbürg. Nous avons erré pendant 5 jours, partout nous nous heurtions aux Alliés. Les Allemands nous trimballaient d’une grange à l’autre, il faisait un froid de canard. Et nous sommes revenues au camp ». Le 7 mai 1945, « ils sont là ». Les tanks américains ont ouvert les grilles du camp de Zwodau.
Gisèle et ses compagnes ont pu partir vers Duisburg, dans des camions pas couverts. Trois jours de voyage, « comme des wagons à bestiaux, mais avec de la paille. Nos pauvres os à fleur de peau ressentaient toutes les secousses du camion. Lors des arrêts, nous allions en campagne chercher des œufs et des poulets, les prisonniers français nous aidaient ».
Franchir le Rhin (le pont n’avait plus de rambarde). Charleville Mézières. Angers. Là Gisèle a pu faire téléphoner à ses parents et au mari de Marcelle Baron. « A Nantes, sur le quai de la gare, j’ai pu voir mon père, ma sœur, mon frère de qui je n’avais plus eu de nouvelles ». A cette évocation la voix de Gisèle se brise. « Pour Marcelle, il a fallu aller chercher une civière. Moi je ne faisais plus que 38 kg mais tout le temps de ma déportation, je savais que je reviendrais, j’étais de celles qui redonnaient confiance aux compagnes qui n’avaient plus le moral »
Gisèle, depuis, témoigne de ce qu’elle a vécu, sans haine : les souffrances, la solidarité, pour que « cela » ne se reproduise pas. Pour la remercier, les enfants ont chanté « Nuit et brouillard ».
Ecoutez Gisèle raconter :
L’arrivée au camp
La vie dans le block 10
Cet article a été conçu par le journal en ligne La Mée
http://www.journal-la-mee.fr/3202-gisele-giraudeau-la-fille-a-la


 Jodl signe l’acte de reddition à Reims
Jodl signe l’acte de reddition à Reims Keitel signe l’acte de capitulation à Berlin
Keitel signe l’acte de capitulation à Berlin (© Yevgeny Khaldei/Corbis)
(© Yevgeny Khaldei/Corbis)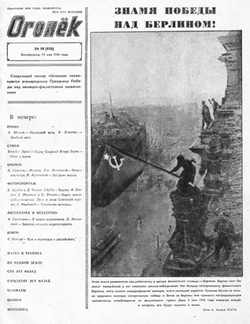 Il a été reproché à Evgueni Khaldei d’avoir réalisé une image de propagande pour exprimer la fierté nationale et témoigner aux yeux du monde de la victoire de l’URSS sur l’Allemagne nazie.
Il a été reproché à Evgueni Khaldei d’avoir réalisé une image de propagande pour exprimer la fierté nationale et témoigner aux yeux du monde de la victoire de l’URSS sur l’Allemagne nazie. (Joe Rosenthal/AP/SIPA)
(Joe Rosenthal/AP/SIPA) (AFP PHOTO / TASS / YEVGENIY KHALDEI)
(AFP PHOTO / TASS / YEVGENIY KHALDEI) (LASKI/SIPA)
(LASKI/SIPA) Arrivés sur le pont qui enjambe l’Oise, un groupe de femmes appelèrent, en pleurant, leurs maris ou leurs fils. Elles furent repoussées violemment par les soldats qui nous encadraient, fusils aux poings.
Arrivés sur le pont qui enjambe l’Oise, un groupe de femmes appelèrent, en pleurant, leurs maris ou leurs fils. Elles furent repoussées violemment par les soldats qui nous encadraient, fusils aux poings. Nous nous préparions à cette évasion tant espérée. La peur, je n’ai pas honte de le dire, m’étreignait quelque peu. Je ne pouvais m’empêcher de penser aux petits piquets qui soutiennent les câbles tout le long des voies et je souhaitais ne pas m’empaler dessus. Au dernier moment me disais-je, j’enroulerai mon blouson de cuir autour de ma tête, cela me protègera.
Nous nous préparions à cette évasion tant espérée. La peur, je n’ai pas honte de le dire, m’étreignait quelque peu. Je ne pouvais m’empêcher de penser aux petits piquets qui soutiennent les câbles tout le long des voies et je souhaitais ne pas m’empaler dessus. Au dernier moment me disais-je, j’enroulerai mon blouson de cuir autour de ma tête, cela me protègera. Cette route qui fut construite par les déportés coûta beaucoup de vies humaines, on l’appelle présentement « La Route du Sang ».
Cette route qui fut construite par les déportés coûta beaucoup de vies humaines, on l’appelle présentement « La Route du Sang ». Photographie de l’arrivée des détenus au camp©AFBDK
Photographie de l’arrivée des détenus au camp©AFBDK 
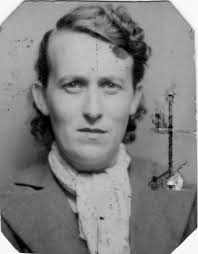
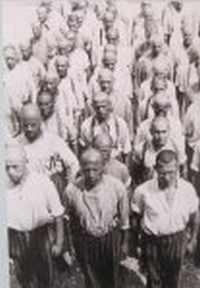

 Prison des Tourelles- Hiver 1943 Marthe est au centre
Prison des Tourelles- Hiver 1943 Marthe est au centre