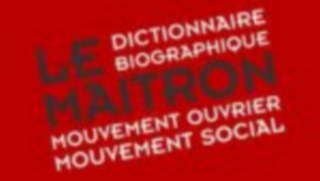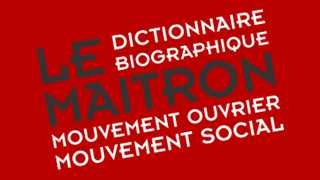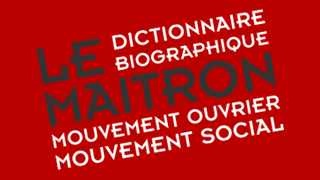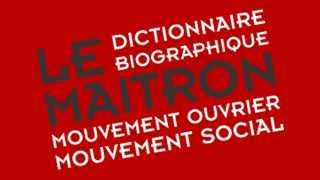Allocution de Monsieur Serge Adry, Président du Comité Local du Souvenir des Héros de Châteaubriant
Cimetière de VILLEPOT
Samedi 22 OCTOBRE 2022 – 14H00
Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élu·e·s,
Mesdames et Messieurs les représentants des familles des fusillés,
Mesdames et Messieurs les représentants d’associations et organisations patriotiques, politiques et
syndicales,
Messieurs les Porte-Drapeaux.
Mesdames, Messieurs, Cher·e·s ami·e·s,
Au nom du Comité Local du Souvenir des Héros de Châteaubriant, je vous remercie pour votre présence
à cette cérémonie.
Le 22 octobre 1941, 27 Résistants tombèrent sous les balles Nazis, 81 ans après nous voilà aujourd’hui à
inauguré cette plaque commémorative aux noms de :
• Edmond Lefebvre
• Henri Pourchasse
• Jean Poulmarc’h
L’histoire de ces hommes sera relatée à la suite de l’inauguration de la plaque commémorative en
leur hommage, plus détaillées.
Une blessure jamais oubliée, rien n’est plus vivant qu’un souvenir.
Ces hommes nous ont laissé la liberté en héritage, et nous voyons aujourd’hui une fois de plus, nous
sommes nombreux aujourd’hui pour cette inauguration de la 9ème plaque commémorative.
Les années passent, mais les souvenirs restent.
Depuis 81 années ont passé, le temps a effacé bien des blessures mais il n’a pas fait disparaître les
cicatrices.
Ces otages furent exécuté sur ordre d’Hitler mais désignés aux bourreaux par le régime de vichy suite à
l’acte de Résistance, contre le représentant du régime Nazi, par de jeunes résistants communistes.
Une mort cruelle et lâche qui leur fut réservée, car hélas ils n’ont pas eu à choisir, ils ont été assassinés.
Mais nous savons qu’ils ont tous su mourir et quitter cette « terre » ce monde avec dignité.
Tous méritent que l’on entretienne leur mémoire, aussi pour que pareil fait ne puissent se reproduire.
Il nous semble indispensable de ne pas oublier et de sensibiliser les jeunes, de leur expliquer pourquoi
ceux qui sont morts ont donné leur vie, alors qu’eux aussi étaient à cette époque en pleine jeunesse et que
de toutes leurs forces ils aspiraient à vivre.
Le meilleur hommage que nous pouvons rendre à ces hommes tombés sous les balles Nazis pour notre
liberté est de poursuivre leur combat.
Ces hommes ne sont pas un tout anonyme.
Ils représentaient la France dans sa diversité sociale et politique, syndicalisme de grande fédération CGT,
communiste…
Notre rôle est aujourd’hui de défendre nos valeurs les plus précieuses
LA LIBERTÉ, L’ÉGALITÉ ET LA FRATERNITÉ
Transmettre ,sauvegarder les valeurs Républicaines qui les animaient aux heures les plus noires de
l’occupation et du fascisme français incarné par Pétain.
Les leçons de l’histoire n’ont pas été retenues et l’humanité est encore incapable de vivre en paix.
20221022_Plaque_cimetiere_Villepot_Allocution_Serge_ADRY_Comite_souvenir_Chateaubriant Mise en page de Patrice Morel – Page 1 sur 2
Oui ,nous avons un devoir de mémoire envers celles et ceux qui écrivirent de leur sang et eurent la
lucidité de nous léguer, dans les pires conditions, le programme du Conseil National de la Résistance.
Les réformes sociales et démocratiques qui en sont l’essence, nous démontrent qu’en luttant pour le
rétablissement des libertés, ils voulaient vivre à en mourir, car ils rêvaient de liberté.
Ils ont légué l’espoir en traçant les perspectives d’une vie libre,une vie d’égalités, de fraternités, et de
solidarités.
Notre génération a des devoirs, ce n’est pas seulement le devoir de perpétuer la mémoire des victimes du
nazisme.
C’est aussi celui de préparer un monde meilleur pour la jeunesse et ceux du reste du monde.
Les jeunes auront à affronter des défis majeurs qui touche les relations entre les hommes et les peuples,
sans oublier le pouvoir inadmissible des armes et celui de l’argent.
Devoir de mémoire et devoir d’avenir se conjuguent donc au même temps, pour nous, le présent qui exige
que l’on sache tenir compte des leçons parfois dramatiques de l’histoire.
L’espoir existe bel et bien, même s’il est inquiétant de voir en ce moment dans les pays du monde, se
répandre les idées racistes et xénophobes à nouveau.
Que chaque passant se souvienne en découvrant ces 9 plaques à Saint Aubin des Chateaux, Sion les
Mines, Lusanger, Moisdon la Rivière, Noyal sur Brutz, Petit Auverné, Erbray, Ruffigné, Villepot, ce qu’ils
ont enduré en sacrifiant de leur vie, victoire sur le fascisme dont ils connaissaient la nature, victoire pour
notre liberté.
Combien de maquisards, de résistants, d’internés, de déportés, de fusillés n’ont pas connu cette libération,
et pourtant ils en ont été des acteurs principaux.
Non ! Il ne doit y avoir aucune place pour le fascisme, le racisme, la xénophobie.
Ces cérémonies doivent être une occasion de porter un message d’ouverture, de respect et de fraternité
entre les peuples, et revendiquer « Plus jamais ça » !
Pour une association comme le Comité local du souvenir des Héros de Châteaubriant, ainsi que pour le
Comité départemental du Souvenir, l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, le musée de la
Carrière des fusillés, le travail de mémoire constitue un droit essentiel pour les jeunes générations.
Les associations mémorielles présentes aujourd’hui sont souvent trop seules à transmettre et faire vivre la
mémoire de la Résistance et de la déportation, le message des combattants de l’ombre.
À la suite de ces cérémonies,le comité locale du souvenir des héros de Châteaubriant avec l’office du
tourisme de Châteaubriant élabora une plaquette du souvenir des 27 inhumés dans 9 cimetières cités
précédemment, cette plaquette s’intitulera « parcours mémorielles ».
Avant de remercier tous ceux qui ont permis ces commémorations je reprendrais une phrase d’Odette
Nilès : « un présent sans passé n’a pas d’avenir »
Je vous remercie de votre attention et vous appel à participer le dimanche 23 octobre à 10h00 à la Blisière
et à la cérémonie officiel du 81ème anniversaire des fusillades de Châteaubriant à 14h00.
Remerciement à la com-com Châteaubriant-Derval, à la Région, au Département, à l’UNC, aux donts
recueillis par le comité local auprès de ces adhérents pour l’apport financier qui permet d’avoir réalisé ces
initiatives dans les communes qui ont pour but de ne pas oublier cette période.
Merci aux Maires d’avoir tout mis en œuvre pour la réussite de ces rendez vous pour la mémoire.
Merci au groupement des associations d’anciens combattants et patriotiques de Châteaubriant par leur
présence des portes drapeaux.
Et ne pas oublié nos artistes ici présents « les gars à la remorque » qui part leur talent nous offre (pas que
aujourd’hui, depuis de nombreuses années) une évocation très précise sur l’événement que l’on célèbre
aujourd’hui, à l’ensemble « Vocal Adulte de pierre Olivier Bigot ».
Merci de votre écoute
Serge ADRY